Engagement et confiance, le duo gagnant
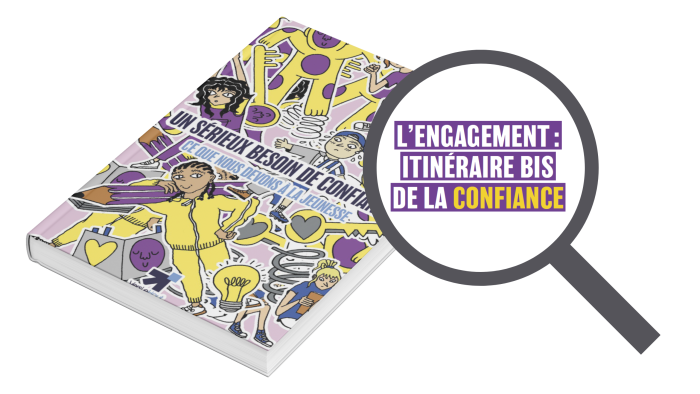
En octobre 2024, VersLeHaut a publié l’excellente étude “Un sérieux besoin de confiance, ce que nous devons à la jeunesse”. Le think tank poste tous les ans son baromètre Jeunesse&Confiance, mais dans cette étude, on plonge plus profondément dans le sujet : quels sont les ingrédients de la confiance ? Quel rôle joue-t-elle dans les trajectoires éducatives et personnelles des jeunes ? Quelle incidence a-t-elle sur la réussite ou sur la santé mentale ? La confiance des jeunes y est décortiquée sous toutes ses formes, qu’elle soit en soi, en le système éducatif ou en les adultes qui les entourent.
Redonner aux jeunesses leur pouvoir d’agir, c’est la mission que s’est fixée Enactus, et contribuer à construire la confiance en soi de ces jeunesses est crucial pour y parvenir. Quand on lit parmi les constats qui introduisent l’étude que 8 jeunes sur 10 renoncent à certaines de leurs aspirations faute de confiance en eux, on ne peut que se demander comment faire notre part.
À l’occasion de la Journée internationale de l’éducation, nous voulons nous pencher sur ce que l’étude dit de l’engagement, qu’elle décrit comme un “itinéraire bis de la confiance”.
Les expériences à l’occasion desquelles les jeunes éprouvent leur utilité sociale constituent des temps privilégiés pour construire la confiance.
— VersLeHaut
L’engagement est une notion floue - si floue qu’un épisode du podcast Les Mots Flous de Sorbonne Université y a été consacré. De la simple prise de position à l’action, chacun y va de sa définition. Dans le cas des 18-25 ans, l’action semble l’emporter : ils sont plus nombreux à voir le fait de donner de leur temps temps aux autres comme une preuve d’engagement (80%) plutôt que le partage de contenus engagés sur les réseaux sociaux (56%). De plus, avec 76% des répondants affirmant avoir déjà donné de leur temps, cette forme d’engagement semble être la plus répandue. Cette perception de l’engagement a-t-elle une incidence sur ce que les jeunes cherchent dans l’expérience d’engagement ?
Ce que les jeunes cherchent dans l'engagement
Selon VersLeHaut, s’engager sous quelque forme que ce soit touche à trois dimensions de la confiance : la confiance en soi, et dans l’idée que son action aura un impact positif sur le monde ; la confiance en l’autre, lorsque l’engagement est collectif ; et la confiance en l’avenir, sans laquelle la démarche se voit vidée de sa substance.
Parmi les compétences que l’engagement aide à développer, la plus citée est la confiance en soi, citée par 47% des jeunes de 16 à 25 ans interrogés par VersLeHaut (chiffre qui monte jusqu’à 51% chez les moins de 20 ans). Juste derrière arrivent la capacité à travailler en équipe pour 44% des répondants, puis la prise de responsabilité pour 42% des répondants. Comparé à l’engagement, le système éducatif n’est identifié que par une minorité de répondants (45% des jeunes de 16 à 20 ans) comme un contributeur au développement de la confiance en soi.
Les chefs d’entreprise interrogés sont également d’accord pour dire que les compétences développées par une expérience d’engagement - confiance en soi, collaboration et prise de responsabilités - sont valorisables au moment de l’embauche.
C’est un point d’entrée du travail que nous menons avec les jeunes : renforcer la confiance en soi, envers autrui, et en l’avenir. Savoir travailler en équipe, par exemple, n’est pas quelque chose d’automatique. [...] Cela implique d’identifier ce qu’il y a de semblable chez les autres, le commun au sein du groupe. Et pour faire grandir tout ça, on s’appuie sur la mise en action, c’est-à-dire le fait de réaliser des choses utiles pour un public qui en a besoin. Il s’agit de faire naître le sentiment d’utilité chez les jeunes, et la reconnaissance chez ceux au service desquels ils agissent.
— Frédéric Naulet, directeur régional d’Auvergne Rhône-Alpes de l’association Unis-Cité
Devant ses bienfaits manifestes sur la confiance des jeunes, quelle place donner à l’engagement dans leur parcours ?
Valoriser les parcours d'engagement
Faut-il rendre accessible l’engagement le plus tôt possible ? Oui. À notre sens, donner une visibilité aux jeunes dès le lycée sur leurs opportunités de s’engager, c’est essentiel. VersLeHaut alerte cependant sur la possibilité que rendre l’engagement une étape obligatoire du parcours éducatif n’en dénature la démarche.
Déjà, parce que c’est avant tout une démarche volontaire, un déclic qui part d’un désir de changement et d’une envie de donner de soi pour servir une cause. En lui retirant sa dimension de volontariat, on atténue son impact sur la confiance en soi.
Ensuite, parce que la voie de l’engagement, qu’elle soit par l’intermédiaire de l’entrepreneuriat ou non, ne doit pas être utilisée pour former des jeunes à être des engrenages de l’économie. L’idée doit rester celle de donner aux jeunes le choix de révéler leur potentiel et agir au service de la société pour cristalliser ce sentiment d’utilité. L’objectif d’initiatives de développement de projets et d’engagement au sein d’entreprises, de structures engagées ou d’organisations en tout genre doit rester un levier de développement de compétences qui servent avant tout aux jeunes avant de servir un objectif financier ou leur simple employabilité.
Enfin, parce que cette vision de l’engagement promeut une approche utilitariste qui menace, selon VersLeHaut et Frédéric Naulet, de creuser les écarts sociaux en valorisant les expériences d’engagement “prestigieuses” au services de causes médiatisées aux dépens des autres.
Alors si l’engagement permet entre autres de donner aux jeunes confiance en eux, les parcours d’engagement devraient être mieux valorisés. Les compétences non-académiques acquises à travers des expériences d’engagement, malgré leur attractivité manifeste décrite plus haut par des chefs d'entreprises, ne sont que trop peu prises en compte par les institutions.
La parole à l'Afev
Depuis plus de 30 ans, l’Afev donne comme Enactus la possibilité à des étudiants et des lycéens de s’engager. L'association croit profondément que donner les capacités aux jeunes de mettre en place des actions pour lutter contre les inégalités éducatives et territoriales peut apporter des solutions durables pour les jeunes de ces territoires, pour leurs familles et pour eux-mêmes.
Grâce à eux, 22 000 étudiants prennent chaque année 2h par semaine pour mentorer un enfant en fragilité scolaire d’un territoire prioritaire de leur ville. Pour la moitié d’entre eux, c’est un premier engagement. Les jeunes qui s’engagent avec l’Afev le font pour se sentir utiles, mais aussi pour développer des compétences transversales sur lesquelles ils pourront s’appuyer dans leurs parcours académique et professionnel. Pour l’Afev, il est indispensable que les volontaires soient à la fois acteurs et bénéficiaires.
La création de liens, l’accompagnement des bénévoles dans la découverte et le renforcement de leurs valeurs ainsi que de leurs envies, sont cruciaux pour l’Afev. Ils constituent un cycle dans lequel des jeunes ayant été mentorés enfants deviennent à leur tour mentors au lycée ou une fois arrivés dans l’enseignement supérieur. On observe alors qu’avoir confiance en soi et mettre quelqu’un en confiance sont, consciemment ou non, des processus complémentaires. Comme une sorte de soutien mutuel. Tout comme le fait de constater les résultats de ses actions : voir que son engagement a un impact positif contribue à prendre en assurance.
L’Afev œuvre également pour mettre l’engagement des jeunes au centre des préoccupations et des projets des différents acteurs des territoires, car les expériences d’engagement sont trop peu accessibles aux jeunes n’ayant plus le statut de lycéen ou d’étudiant. L’association voit dans les expériences d’engagement la possibilité de “construire un autre modèle social dont les jeunes sont des acteurs de premier plan”, une “brique essentielle de la construction de leur citoyenneté et de leur confiance en la démocratie malgré les inégalités”. Une approche d’autant plus pertinente que la confiance en soi est encore plus souvent identifiée comme une compétence liée à l’engagement par les jeunes les moins diplômés - 54% chez les détenteurs du seul brevet des collèges contre 42% chez les jeunes à bac+2 et au-delà.
Pour que l’engagement des jeunes soit durable, il ne doit pas être sacrificiel.
— L'Afev
Ce que nous devons à la jeunesse
Aujourd’hui, ce que nous devons à la jeunesse, ce sont des options : donner accès à une expérience d’engagement c’est donner une chance à tous les jeunes, quel que soit leur parcours et leur milieu, d’exploiter leur potentiel sans être orientés de manière arbitraire vers une quelconque voie de formation.
Nous leur devons également de la reconnaissance. L’engagement permet de vivre des expériences transformatrices et vectrices de compétences, qui bénéficie à la fois à ses acteurs et à ses bénéficiaires. C’est un choix personnel qui doit être mis en avant et félicité, dans le parcours académique comme professionnel, car le développement des compétences qu’il permet n’est pas systématique dans le parcours des jeunes et encore moins à l’école. Et c’est sans parler des engagements invisibles ou non-choisis, ceux qui passent sous les radars des institutions, comme s’occuper d’un parent dépendant - cas qui concerne 38% des jeunes de 16 à 25 ans résidant dans les quartiers prioritaires.
La démarche de s’engager doit autant que possible rester un choix intentionnel et le système éducatif ne doit pas l’imposer mais plutôt le démocratiser, le mettre en lumière comme un pilier de développement humain. Des structures comme l’Afev luttent depuis longtemps pour faire passer ce message, et ce type d’organismes continue d’apporter des solutions pour permettre à des jeunes de tous horizons de reprendre possession de leur pouvoir d’agir, et doit être valorisé et soutenu.
Sources :
- "Un sérieux besoin de confiance, ce que nous devons à la jeunesse", 2024 , VersLeHaut
- "Baromètre Jeunesse&Confiance 2025 – La famille : un pilier éducatif fragile", 2025, VersLeHaut et OpinionWay
Écrit par Sofia & Léna
